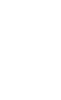La santé mentale des salarié·es se dégrade, et les causes de ce phénomène évoluent, intégrant désormais l’éco-anxiété. D’après le Conseil économique social et environnemental (CESE), huit Français sur dix sont inquiets face aux conséquences du changement climatique sur le monde.
Si la définition de l’éco-anxiété ne fait pas consensus, on peut citer la définition de chercheurs australiens et néo-zélandais : « L’éco-anxiété est un terme qui rend compte des expériences d’anxiété liées aux crises environnementales. Il englobe l’anxiété liée au changement climatique, tout comme l’anxiété suscitée par une multiplicité de catastrophes environnementales […] »[1].
Dans le cadre de la Semaine de la QVCT, nous avons co-organisé avec KissKissBankBank, YouMatter la conférence « L’éco-anxiété en entreprise : frein ou moteur de la transformation écologique et sociale ? ».
Quatre expert·es sont intervenu·es :
- Pierre-Eric Sutter, psychologue du travail, psychothérapeute, directeur de l’Observatoire de la vie au travail et dirigeant de mars-lab et de Econoïa, la Maison des éco-anxieux
- Peggy Masse, coach et consultante RH, co-fondatrice du collectif Buddleia et ancienne RH chez Decathlon France
- Anne Le Corre, co-fondatrice de Printemps écologique, syndicat écologique de salarié·es
- Catherine Brennan, Directrice Générale de Birdeo.
L’éco-anxiété, nouvel enjeu QVT dans le recrutement ?
Depuis 2010, Birdeo accompagne les organisations dans le recrutement des talents qui rejoindront les Directions RSE et les différentes fonctions œuvrant à la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux. Selon Catherine Brennan, l’éco-anxiété ne fait pas partie des sujets abordés lors des échanges avec les candidat·es ou les entreprises, pour lesquelles le cabinet recrute.
Ce constat surprenant peut trouver une explication : une fois recrutées ces personnes trouvent dans leur quotidien et les actions qu’elles peuvent mettre en œuvre, des réponses à ce besoin d’agir en faveur d’une transformation durable.
Par ailleurs, nous observons que « l’éco-lucidité »[2] et « l’éco-anxiété » peuvent être le moteur d’un désir de reconversion professionnelle vers les métiers à impact positif.
Qui sont les éco-anxieux ?
En 2021, The Lancet dévoilait une étude menée parmi les jeunes de 16 à 25 ans : 59% des personnes interrogées se disaient très voire extrêmement inquiètes par le changement climatique[3]. De manière générale, de nombreux facteurs liés à la crise sanitaire, la climat politique et social, et les conséquences du dérèglement climatique ont participé à la dégradation de la santé mentale chez les jeunes.
Malgré quelques disparités, Pierre-Eric Sutter confirme que l’éco-anxiété concerne toutes les classes d’âge. Cependant, de nombreuses études scientifiques sur le sujet démontrent que les femmes sont plus éco-anxieuses que les hommes[4]. Il existe également des pics d’apparition de l’éco-anxiété, constatés aux alentours de 32 ans chez les femmes et 50 ans chez les hommes.
Concernant la situation au sein des équipes travaillant sur les enjeux environnementaux, Peggy Masse décrit une montée des risques psycho-sociaux, parmi lesquels le stress et l’éco-anxiété.
Si les personnes en recherche d’une nouvelle opportunité ne présentent pas de signes d’éco-anxiété, la situation est souvent plus compliquée chez les personnes en poste depuis plusieurs années. En effet, la lucidité des collaborateurs sur l’urgence climatique est parfois confrontée à un sentiment d’impuissance ou celui ne pas avoir un impact suffisant par rapport à la gravité de la situation.
Au travail, l’éco-anxiété peut avoir des impacts négatifs sur les interactions sociales : le sentiment d’impuissance produit de l’épuisement, mais peut aussi engendrer de la frustration, de l’agressivité voire un isolement progressif. Dans les cas les plus graves, les salarié·es font un « burn-out écologique », fruit d’une éco-anxiété prolongée et méconsidérée par l’employeur.
Eco-anxiété : quelles solutions en entreprise ?
Ces dernières années, l’éco-anxiété est devenue un facteur de risques psychosociaux (RPS) au travail. L’employeur a la responsabilité d’évaluer les risques et de proposer des mesures de prévention, d’information et de formation.
Selon Peggy Masse, les entreprises craignent d’interroger leurs équipes sur l’impact de l’éco-anxiété, et ainsi « d’ouvrir la boîte de pandore ». Pour prendre en charge ce nouveau risque, Pierre-Eric Sutter propose trois niveaux de prévention :
- Primaire : réaliser un audit spécifique sur le risque d’éco-anxiété, pour en identifier les causes ;
- Secondaire : mettre en place des actions de prévention et de sensibilisation auprès des collaborateur·rices, et plus particulièrement des managers ;
- Tertiaire : sensibiliser les praticien·nes pour soigner et accompagner les personnes souffrant d’éco-anxiété.
Finalement, la prise en compte de l’éco-anxiété est concomitante à la connaissance des enjeux environnementaux. C’est pourquoi, Catherine Brennan encourage une intégration progressive de la RSE dans l’ensemble des métiers, grâce à des programmes de formation spécifiques à chaque fonction. La compréhension de l’éco-anxiété doit passer par l’éco-lucidité.
Enfin, il existe une dernière mesure qui peu à peu fait son apparition dans certains secteurs à l’image du conseil : le droit de retrait écologique et éthique. Pour Anne Le Corre, ce droit est une réponse importante à l’éco-anxiété et une forme de reconnaissance permise par l’écoute et la déculpabilisation des salarié·es.
[1] Teaghan L. Hogg, Samantha K. Stanley, Léan V. O’Brien, Marc Wilson et Clare R. Watsford, « The Hogg Eco-Anxiety Scale: Development and validation of a multidimensional scale », Global Environmental Change, novembre 2021.
[2] Eco-lucidité : perception et compréhension du dérèglement climatique et plus globalement des enjeux écologiques encourageant à l’action.
[3] Hickman, C., Marks, E., Pihkala, P., Clayton, S., Lewandowski, R. E., Mayall, E. E., Wray, B., Mellor, C., & Van Susteren, L. (2021). Climate anxiety in children and young people and their beliefs about government responses to climate change : a global survey. The Lancet. Planetary Health, 5(12), e863‑e873. https://doi.org/10.1016/s2542-5196(21)00278-3
[4] OBSECA. (2023). L’éco-anxiété en France, Etude OBSECA 2023. Dans OBVECO. https://obveco.com/wp-content/uploads/2023/05/Etude-OBSECA-synthese-web-2023.pdf